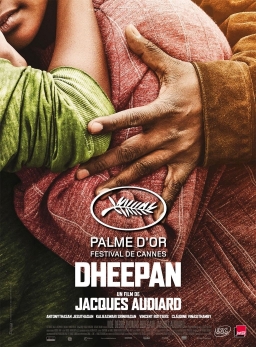Chez Nous, de Lucas Belvaux, est un film sur les routes et les autoroutes politiques. Le film commence et s’achève par une image scindée en son milieu, montrant d’un côté une petite route traversant le village d’Hénard dans le Pas-de-Calais (double fictionnel d’Hénin-Beaumont), et de l’autre une autoroute. Car c’est bien un choix de route que doit faire Pauline Duhez (Emilie Dequenne), infirmière à domicile qui sillonne le coin en voiture, approchée par son médecin de famille, Philippe Berthier (André Dussolier), pour être tête de liste du Rassemblement National Populaire, d’Agnès Dorgelle (Catherine Jacob), émanation du Bloc patriotique. Hésitante mais tentée, une scène montre l’héroïne somnolente au volant, puis sa brutale sortie de route, symbolisant celle qu’elle est en train de faire en rejoignant ce courant politique. A l’inverse, c’est encore sur une route, en voiture avec son mentor, de retour d’un meeting de Dorgelle, qu’elle aura son épiphanie et que son engagement s’affermira. C’est à nouveau sur la route qu’elle saisit son illégitimité et son incompétence politique, en écoutant des commentateurs radio railler sa blondeur et son mutisme lors d’un point presse commun avec la cheffe du parti. Et c’est originellement en s’éloignant d’Hénard et en prenant l’autoroute de Sedan qu’elle a pu rencontrer Dorgelle pour la première fois.
Le film ausculte donc les formes de l’engagement politique, illustrant divers phénomènes que la science politique avait pu repérer, et notamment le fait que l’entrée en politique, ici un peu par hasard et par nécessité, précède la politisation et l’appartenance partisane. Mais il dit aussi que l’action publique est l’ennemi du bonheur privé, tant l’embrigadement de Duhez fait entrer la violence dans sa vie. Une réplique d’une amie et opposante de la jeune candidate dit bien que c’est le parti même qui génère cette violence, car il ne porte que des divisions. La Marseillaise chantée au meeting de Dorgelle résonne d’ailleurs étrangement dans la bouche des militants chauffés à blanc, retrouvant ses accents de chant guerrier originaire, et ici exclusionnaire. Elle s’oppose à la Marseillaise entonnée au stade de foot un peu plus tard, qui se veut chant intégrateur et festif.
On est chez nous
Le « on est chez nous » scandé par les partisans de Dorgelle, et qui donne son titre au film, semble surtout un entre-soi. Belvaux ouvre et clôt le film par des plans larges de paysages du Nord, filmés de loin, où les imposants terrils semblent à la fois écraser les personnages et les couper du monde. On ne vit pas si mal à Hénard, mais on n’y vit pas bien non plus. Les corons désertiques paraissent sortis d’un plan baltimorien de The Wire. Une voire deux générations après la fermeture des mines, il ne reste plus grand-chose de l’ancienne socialisation ouvrière, à l’exception du père communiste, fier de ses combats et de ses valeurs, qui renie sa fille dès l’annonce de son engagement. Pour le reste, ça travaille correctement, ni dans l’opulence ni dans la pauvreté. On est chez les « gens de peu », durs à l’ouvrage, dans cette « France qui se lève tôt ».
Mais la relégation est suggérée, et le rapport à Paris comme au reste du monde s’incarne uniquement dans le désir de « faire sauter le système », de ne plus voter ou surtout de voter RNP/FN, et de survaloriser l’appartenance identitaire et locale. L’écho de l’extérieur arrive en flux incontrolés, sur Internet ou à la télévision, dans les images mortifères de Daech, les chansons populistes de Patrick Sébastien (« Ah… si tu pouvais fermer ta gueule« …), les imprécations d’Eric Zemmour, ou des documentaires animaliers évoquant la lutte entre espèces, qui font écho au thème du « grand remplacement » qui irrigue les esprits, et que rien dans le contexte local ne vient attester. Le racisme n’est pas central, mais il est là, ordinaire et accepté, relevant davantage du sentiment de dépossession des lieux que d’une quelconque hiérarchisation sophistiquée des « races » (Dorgelle aura des accents barrésiens dans son discours, mais on sait que l’idée d’une suprématie blanche ou indo-européenne constitue un vieux fonds des partis nationalistes). Pauline ne dit jamais rien contre les Musulmans, mais ça parle sans détour autour d’elle et au parti. Ironiquement, elle sera exfiltrée du quartier qui s’enflamme par la fille de sa patiente d’origine maghrébine, qui avait refusé de la voir (subtilement, d’ailleurs, entre deux visites, la mère s’est désormais voilée, mais pas la fille). L’autre est flou, la « menace » diffuse ou construite, mais chacun joue sa partie : à la violence des jeunes de la cité s’oppose la violence des néonazis, tout aussi mutique et dépolitisée, mais armée et sanglante.
Si Pauline tente d’entrer en politique, la politique entre dans les familles, avec son cortège de violence aussi. En une scène terrible où un père qui s’inquiétait que son fils adolescent ne surfe sur des sites pornos découvre qu’en fait il anime un blog identitaire, que sa mère soutient immédiatement, avant de frapper son mari qui lui en veut d’avoir basculé politiquement, et qu’il frappe aussi en retour. Le mal est fait dans cette famille, où à l’éloignement amoureux des conjoints correspond un éloignement politique, une fois que le RNP est vu comme comme le seul recours par la mère et le fils. Toute l’impuissance du pater familias devant l’effondrement de ses certitudes s’achève dans la destruction de l’ordinateur, donc dans l’effacement des images diaboliques, ici, comme le veut l’étymologie, réellement porteuses de division.
Le marché des images
C’est bien l’entre-soi qui borne les horizons. C’est au nom de la communauté villageoise que tout est entrepris, même si « la France » est invoquée. Pauline accepte de s’enrôler parce qu’elle pense élargir simplement son métier de soins médicaux à une entreprise plus vaste de soins politiques. Mais le RNP ne saurait apporter un quelconque « apaisement ». Comme d’autres partis, il est le lieu des combines et des secrets, débordés par ses petits nazillons qu’il voudrait cacher sous le tapis, et où l’on compte Stéphane (Guillaume Gouix), le nouveau compagnon de Pauline (en fait son ancien petit ami de lycée, ce qui confirme l’entre-soi et sa fixité). Dussollier incarne le notable retors et magouilleur, chabrolien mais avec l’idéologie en plus, qui ne rêve que d’une révolution nationale pétainiste. Il dévoile progressivement à la profane en politique, comme à Stéphane, les règles du jeu : le costume trois-pièces ne vaut que pour la respectabilité, car derrière l’apparence, la haine et la violence revanchardes sont toujours là, on a juste rhabillé ceux qui faisaient le coup de poing ; la dimension secondaire du programme politique, par rapport aux éléments de langage qui structurent la campagne ; le candidat comme homme de paille, « cornaqué » par des cadres du parti, comme le dit trop explicitement la chargée de communication de Pauline. Et le récit – originellement un livre de l’étonnant Jérôme Leroy, Le Bloc – témoigne bien de la professionnalisation de l’extrême droite, de sa bonne structuration partisane, et de la présence nouvelle de diplômés sortis des écoles de la République ; extrême droite à laquelle il ne manque que l’ancrage et les candidats sur le terrain.
Le film enregistre alors la manière dont le RNP essaie de se forger une « image ». Il met en scène le marché des images politiques : la transformation mimétique en femme blonde de Pauline, à l’image de Dorgelle, et sa présence à ses côtés pour l’affiche de campagne. Son remplacement final sur la même affiche, par son autre amie, plus militante qu’elle ; signe de l’interchangeabilité des candidats RNP. La mauvaise image dont pâtit Pauline dès qu’elle annonce son ralliement à Dorgelle, qui déclenche à la fois des affrontements dans la cité où elle exerçait habituellement et les affrontements avec son entourage. Image terrible enfin de la violence des ratonnades de migrants auxquelles se livre Stéphane, et qui lui vaudront sa disgrâce. Il n’y a alors qu’en sortant de l’image que Pauline pourra espérer reprendre le cours de sa vie (comme le personnage joué par la même Emilie Dequenne devait fuir sans laisser d’adresse l’enseignant parisien indifférent dont elle était amoureuse, dans Pas son genre, le précédent film de Lucas Belvaux).
Tout récemment, L’Exercice de l’Etat, de Pierre Schoeller (2011), s’était imposé comme film politique réaliste (et au passage comme outil pédagogique), mais sa limite était qu’il se déroulait uniquement dans le champ politique central, à l’exception de quelques scènes. Chez Nous a l’avantage de jouer sur les deux échelles, locale et nationale, militante et professionnelle, et filmant d’ailleurs ce qui se passe quand les deux se rencontrent, et que la candidate ad hoc parle à la responsable aguerrie (au passage toujours, ce long-métrage fera aussi un bon outil en cours…). A quelques semaines de l’élection présidentielle, où le score de Marine Le Pen inquiète, cette fiction politique n’en est que plus importante. Ni anticipation, comme la bande dessinée La Présidente, de François Durpaire et Farid Boudjellal, ni documentaire comme l’étonnant roman-photo de Valérie Igounet et Vincent Jarousseau, L’illusion nationale. Deux ans d’enquête dans les villes FN (chroniqué bientôt sur ce blog), Chez Nous règle la mesure sismique sur la plus basse intensité, celle que ne voient plus les éditorialistes ou journalistes coupés du « terrain », celle que ne veulent pas voir les partis, qui renvoient les électeurs frontistes aux abîmes du fascisme, et celle que tous les autres redoutent de voir provoquer un très grand tremblement de terre.
25/02/2017