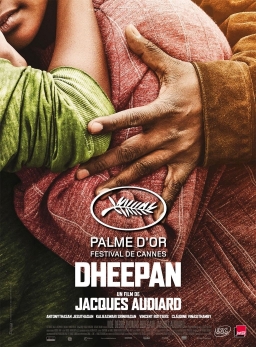A propos d’Ils sont partout d’Yvan Attal (2016)
Dans les périodes troublées, il y a les idéologues candides qui se font les idiots utiles de la haine de l’autre, et il y a ceux, comme Yvan Attal, qui gardent leur honneur et tentent de répondre, comme réalisateur, comme républicain, comme juif, comme homme, au malaise qu’éprouvent les Français juifs depuis une quinzaine d’années maintenant. Son film, Ils sont partout, met des images et des mots sur ce qu’a pu faire l’antisémitisme renaissant, mais surtout sur la violence faite à l’être par une assignation identitaire extérieure et non désirée, qui ne correspond pas à ce qui peut être profondément ressenti. Le propre des idéologies racistes est à la fois une réduction de l’autre aux caractéristiques supposées, et souvent négatives, de son groupe tout aussi supposé d’appartenance, mais aussi l’assignation qui lui intime de ne plus exister hors de ce groupe ; quand bien même il se sentirait appartenir à mille groupes différents ; quand bien même l’identité qu’on lui impose ne représenterait rien pour lui.
Ces temps troublés sont précisément pour les Français juifs ceux qui les auront vus, à nouveau, livrés à la vindicte populaire, accusés de communautarisme, accusés de double allégeance envers la France et Israël, de « sionisme », accusés de comploter nationalement et mondialement, et au fond en partie « dénaturalisés », car considérés brutalement comme des immigrés de fraîche date ayant, eux, réussi leur intégration. Cet antisémitisme n’est pas d’Etat, mais il n’en est pas moins vif, sur les réseaux sociaux, dans les déclarations de tel ou tel agitateur politique, se déposant dans certains esprits et certains milieux comme une évidence. Son second souffle s’est fait progressivement plus violent, partant de tensions ou d’actes antisémites, pour, quand il a croisé la route de l’islamisme, se faire meurtrier. Des Français juifs ont été tués comme juifs à Toulouse, à Bruxelles, et à Paris. Si l’assassinat de jeunes enfants toulousains avaient été étrangement bien peu suivi de réactions populaires, les « Je suis juif » du 11-Janvier ont eu quelque chose de rassurant. Mais le mal était fait, et l’inquiétude est devenue plus sourde, car l’histoire européenne enseigne hélas que l’antisémitisme est mobilisateur, jubilatoire, et qu’il ne s’arrache pas des esprits comme une mauvaise herbe. La déradicalisation est une vue de l’esprit quand les conditions sociales de la radicalisation sont toujours présentes. Et elles le sont.
La souveraineté était indivisible, mais apparemment le peuple l’est. Et plus l’Etat-nation s’affaiblit, plus les particularismes jusque-là vécus intimement deviennent les échelons centraux de l’existence sociale. Dans Les désarrois d’un fou de l’Etat, Pierre Birnbaum écrit que la fin de « l’alliance verticale » historique entre l’Etat et les juifs, qu’il a émancipés, « pousse à la communautarisation qui remplace peu à peu la communauté des citoyens et est porteuse d’affrontements potentiels » (p.237). Ceux qui n’existent désormais plus que dans ces particularismes ne voient plus ni un citoyen chez l’autre, ni un frère (celui de la « Fraternité »), mais un juif, un musulman, une femme, un homosexuel, un « roux » ou un « blond », dans le film. Et ces catégories construites tiennent lieu de grille de lecture générale de ce qui animerait l’autre et le ferait penser. Ils sont partout commence d’ailleurs sur ces catégories troublées, trouble de celui qui essaie de qualifier l’autre et trouble de celui qui est ainsi qualifié. C’est le premier « sketch » du film (Ils sont partout est un « film à sketches » humoristique empreint de gravité), où un admirateur bien lourd du personnage d’acteur que joue Yvan Attal, s’essaie à lui apposer une étiquette, tombant chaque fois à côté, le qualifiant tour à tour d’Israélien, d’Hébreu, d’Israélite, ou de Feuj, là où Attal essaie, en vain, de lui opposer sa propre qualification, la plus simple, celle de Juif ; tout en disant bien qu’elle est une étiquette parmi d’autres, que son interlocuteur s’efforce seul de grossir.
Tout le film évoque l’arbitraire de l’assignation identitaire, les crises tout aussi identitaires qu’elle provoque chez celui qui en est victime, et les résistances qu’il est possible de lui opposer. Ainsi, selon les séquences, on aura tour à tour le dirigeant antisémite d’extrême-droite qui apprend sa judéité, et commence à s’y conformer fantasmatiquement et biologiquement, trouvant son nez crochu ; le petit zonard de banlieue qui ne veut plus être juif car il n’en tire pas le bénéfice supposé de la richesse ; l’agent du Mossad envoyé dans le passé tuer l’enfant Jésus, tombant amoureux de Marie, et lui vouant à son retour un culte tout chrétien; et Yvan Attal lui-même qui, à la fin du film, dit : « Je rêve d’être goy, je rêve d’être antisémite, juste pour voir le trip. » Tout est affaire de catégorie, et celle de « juif » fonctionne comme un opérateur magique qui devrait produire des effets. Le petit passage très « talmudique » entre deux juifs hassidiques devisant sur une parabole évoquant un ramoneur noir de suie et un ramoneur encore blanc, renvoie lui aussi à la différence entre la perception externe (les ramoneurs se glissent dans ces catégories de noir et de blanc) et la perception interne (le ramoneur noir sait-il qu’il est recouvert de suie ?).

Deux juifs hassidiques parlent de deux ramoneurs (Grégory Gadebois et Denis Podalydès. © David Koskas)
Si chaque sketch est précédé d’un carton indiquant un cliché sur les juifs (ils ont de l’argent, ils s’entraident, ils complotent, ils ont le monopole de la souffrance, etc.), il s’agit moins pour Yvan Attal de démonter le cliché ou d’attaquer frontalement les antisémites notoires, que de montrer ce que veut dire se débattre avec une assignation extérieure dans laquelle on ne se reconnait pas, ou plus, et l’inanité des lieux communs attachés à cette assignation quand on la confronte au réel. Les personnages du film s’épuisent tous, juifs et non-juifs, davantage avec une condition sociale, professionnelle et intime, qu’avec l’assignation externe qui leur pèse ou les déstabilise. A la fin de chaque sketch, le cliché s’effondre ridiculement, mais une leçon, parfois pessimiste, peut être tirée par les personnages comme par les spectateurs, qui éclaire ce malaise que peuvent éprouver les juifs de France. Ainsi d’une séquence assez drôle où les Français se convertissent par référendum au judaïsme (afin de « s’entraider »…), avec comme effet terrible pour le pays de devenir un nouvel Israël, cible d’une attaque de roquette sur la capitale. De même, la tentative pour tuer Jésus enfant afin d’éviter tout l’antijudaïsme chrétien se solde par le remplacement de Jésus sur la croix par l’envoyé du Mossad, et la naissance d’un culte à son nom, identique au culte chrétien (il rejoue à son corps défendant la scène primitive de la crucifixion, le déicide, matrice de l’antijudaïsme médiéval). La force des structures l’emportant sur toute initiative individuelle. Mais chaque sketch aura aussi mis en scène des juifs très différents, irréductibles les uns aux autres (le sépharade névrosé, l’ashkénaze auquel on a caché sa filiation, le rescapé des camps, le « petit juif » de banlieue, l’agent israélien, le juif loubavitch, etc.), qui témoignent de l’inanité de l’expression « communauté juive » comme de toute catégorisation univoque du type « les juifs ».

Quand le particularisme devient l’identité (© David Koskas)
Le film d’Yvan Attal plaide donc pour le refus de toute assignation identitaire, et prône une position républicaine universaliste, où la citoyenneté est l’échelon où chacun peut vivre avec l’autre sans être réduit à un quelconque particularisme. Où ce qui compte est l’individu davantage que le groupe, et son personnage pense accepter le rôle d’un musulman dans un film ou une pièce de théâtre, car il s’est identifié au destin de cet homme. Il rappelle au passage, par la voix de l’ethnopsychiatre Tobie Nathan qui joue son propre rôle, que « Juif » n’est pas un état, un être, une ethnie, une condition biologique, mais des actions : la spiritualité, la pratique, l’inscription dans une filiation historique, et surtout la transmission.
13/06/2016