A propos de Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2014, 567 p.
L’ouvrage de Johann Chapoutot témoigne qu’il est possible de faire une grande œuvre sans encombrer le lecteur de mille considérations épistémologiques, qui sont trop souvent un méta-discours destiné à masquer l’indigence du propos central. Ici, c’est exactement le contraire, car l’ambition est d’éclairer un objet mal connu – la pensée nazie telle qu’elle se déploie à partir des années 1930 sous la plume de juristes, de médecins, ou d’idéologues organiques du parti national-socialiste –, tout en considérant que l’épistémologie, la méthodologie et l’historiographie du nazisme se font « en marchant ». J. Chapoutot consacre seulement ses dernières pages à réinscrire son travail dans l’historiographie de la période, et à inviter à prendre au sérieux les textes théoriques de cette période. Son idée est non seulement qu’il faut exhumer la « pensée nazie », dans ses diverses sources, au-delà des propos des dignitaires les plus connus ou de Mein Kampf ; mais encore qu’il faut prendre au sérieux cette pensée, en ce qu’elle constitue le lieu à partir duquel se déploient tout le vocabulaire propre (la langue du IIIe Reich étudiée par Victor Klemperer), et toutes les représentations et la vision du monde des nazis. Il ne s’agit pas de poser mécaniquement un lien entre idées et pratiques, mais il ne s’agit pas non plus de nier ce lien. Car la pensée nazie produit un univers mental, un univers de sens, qui initie et justifie l’action politique, comme la violence. A la lecture de l’ouvrage, il devient difficile d’affirmer que les idées politiques n’ont aucun effets politiques, et que les deux existeraient sur des plans différents. Ce que disent les penseurs nazis n’est pas une pensée savante qui n’atteindrait que les couches les plus éduquées de la population. C’est au contraire une pensée accessible, maniant les poncifs, désignant des ennemis, exaltant le peuple ; c’est une pensée répétée des années durant, qui irrigue toute la propagande, la formation idéologique, et pénètre profondément la société allemande. Ce que les nazis entreprennent ensuite se veut l’incarnation directe de ce qu’ils ont préalablement posé, même si ce programme s’adapte à la situation, et apparaît évolutif en fonction de ce que la guerre fait au nazisme lui-même.
Johann Chapoutot entreprend donc de se confronter à ce véritable continent qu’est la littérature doctrinale des nazis et de leurs séides. C’est là que s’élabore un système de pensée complet et cohérent. La vision du monde nazie met le corps biologique du peuple allemand au centre de l’histoire et de l’avenir, dans une perspective racialiste (les acteurs collectifs du développement sont des races différentes, pourvues de caractéristiques différentes) et raciste (certaines races sont supérieures à d’autres, dont l’anéantissement peut être dans l’ordre de la nature), pour reprendre des catégories dégagées par Pierre-André Taguieff (La Couleur et le Sang. Doctrines raciales à la française). Cette race est, simultanément et contradictoirement, menacée par le mélange et la volonté de domination des autres races, et appelée à un destin glorieux, de ressourcement et de conquêtes, que le nazisme entend mettre en œuvre. Ce pessimisme historique, mâtiné de rêves glorieux pris en charge par un « Reich de mille ans », est la source de ce qu’entreprennent les nazis, et qui forme au passage la summa divisio de l’ouvrage de J. Chapoutot : procréer pour la communauté organique, combattre pour la défendre, et régner sur l’Europe ; mais en gardant bien à l’esprit que ces trois programmes se tiennent.
L’idéologie nazie déconstruit absolument tout ce qui avait pu être porté par le judéo-christianisme et le libéralisme, pour leur substituer d’autres « valeurs » morales, une éthique, des normes et des impératifs, et pour refonder une civilisation entière. Elle opère par revivalisme d’un âge d’or mythique, et par une révolution « radicale », au sens propre de retour aux racines, de retour à une « germanité » pure, à la race allemande antique et authentique, pré-chrétienne, débarrassée des fausses avancées de la modernité. Il faut mettre à bas toute construction artificielle, à commencer par le droit positif. Car, « c’est bien la vie qui dicte la norme » (p.78), et l’homme allemand sent instinctivement ce qui est juste. L’édifice législatif est dénoncé par les juristes eux-mêmes qui, portant la vision nazie, vont lui substituer un droit immanent au peuple. En août 1933, lors d’un camp d’été de stagiaires avocats et magistrats, on pendra symboliquement un paragraphe en effigie (§) pour bien signifier la mort de l’abstraction et de l’écrit dans le régime qui s’annonce. Débarrassé de la gangue de la codification, le droit allemand trouvera sa source dans le bon sens populaire, dans la vision du monde national-socialiste des juges, et bien sûr dans la volonté du Führer, interprète suprême des lois de la nature.
La chair commune, le sang partagé et la race identique permettent de nourrir un primordialisme biologique du peuple allemand, dans lequel toute cette pensée s’ancre. La préservation de la race allemande est une mission sacrée, qui implique un désintérêt, ou surtout une haine de tout ce qui n’est pas elle. Cette sacralisation de la race inaugure un geste inouï de séparation du peuple allemand de l’humanité commune. Les nazis se figurent la nation allemande comme un îlot menacé, dont l’existence même est en jeu, et qu’il faut défendre contre les menées des autres peuples. Sous cet aspect, les autres peuples ne comptent littéralement pas, et sont perçus uniformément comme des ennemis mortels ; notamment les Slaves et les Juifs, y compris les compatriotes de confession juive, donnés comme irrémédiablement étrangers, et que les lois nazies, entre 1933 et 1941 vont s’employer à dénationaliser, avant le recours à la violence. La vie des non-Allemands n’ayant aucune valeur, ce sont ainsi 3,5 millions de soldats russes prisonniers que le régime va laisser mourir en moins d’un an. L’Eglise, la Révolution française puis le communisme ont inventé l’égalité raciale, en faisant fi des hiérarchies naturelles et de la lutte des races. Or, « l’hygiène raciale » commande d’éliminer tout ce qui menace le corps biologique allemand : handicapés physiques et mentaux (l’ordre en est donné en 1939), criminels, « dégénérés » en tout genre, homosexuels, « races inférieures », etc. Les nazis mettent ainsi en place une « biopolitique », au sens de Michel Foucault, destinée à préserver l’unité et la pureté organiques de la race allemande. Sous ce prisme, les Juifs n’étant « ni proprement humains ni vraiment animaux, rappelle J. Chapoutot, ils ressortissent au bactériologique plus qu’au droit commun biologique » (p.43). Dès lors, leur élimination physique relève d’une mesure prophylactique, une mesure de défense.
Tout au long de leur entreprise de mort, les nazis n’auront pas nécessairement conscience de commettre un immense crime, mais au contraire d’accomplir une tâche historique, un « sale boulot » qu’aucun autre peuple européen ne prendrait en charge. Comme a pu le montrer Philippe Burrin dans Ressentiment et apocalypse, c’est bien une lutte à mort qui oppose les « Aryens » aux Juifs, une lutte existentielle, qui explique le recours à une violence sans limite contre les Juifs, et la poursuite de leur destruction (on songera aux juifs hongrois à partir de 1944), alors même que la guerre s’annonce perdue. Les Juifs ne gagneront pas la guerre, avait annoncé Hitler dès 1939, même si les Allemands la perdent. Glaçante prophétie auto-réalisatrice, qui est en fait un programme. Au crépuscule du Reich, dans un dernier geste de nihilisme historique, Hitler ordonnera la destruction des infra-structures allemandes. Son peuple n’a pas été à la hauteur de la mission qui lui avait été assignée, et le triomphe des masses de l’Est est inévitable. Dans son esprit, l’engloutissement du peuple allemand ne fera que confirmer l’irrémédiable faillite tant redoutée, à laquelle toute l’idéologie nazie voulait résister.
La fantasmatique nazie se pose en s’opposant. Elle fait de sa vision du judaïsme le contre-modèle absolu de ses dogmes. Cette religion orientale, « fable asiatique » (p.85) étrangère à l’histoire et à l’être allemand, dont le christianisme a été le faux nez victorieux, a exporté en Europe une vision complète de l’homme qu’il faudrait récuser violemment : le matérialisme, la haine du réel au profit de l’abstraction, la souffrance animale dans l’abattage rituel, le péché de chair, le refus de la nudité naturelle, un rapport médié à Dieu, l’aide aux plus faibles, la soumission à des lois externes, là où les nazis n’en ont pas besoin car ils savent spontanément se contrôler, et finalement la réflexion et la conscience mêmes. « La conscience est une invention juive », déclare ainsi Alfred Rosenberg devant un parterre de préhistoriens. Le judaïsme se voit dénié le nom de religion, il est une appartenance raciale, dans la logique propre du nazisme qui ne voit plus que peuples et races d’origine naturelle. C’est le triomphe d’une vision essentialiste du devenir historique et du fonctionnement des groupes. Non seulement les collectivités humaines sont essentialisées, rendues an-historiques dans leur fonctionnement (le mal élémentaire des Juifs est une caractéristique héréditaire), mais encore, comme avaient pu le montrer Emmanuel Lévinas dès 1934 dans ses Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, et son commentateur Miguel Abensour, la doctrine nazie invente « l’être-rivé », assigné à son corps, à son héritage biologique et racial, dans une négation absolue de sa libre volonté.
Un dernier point, pour ouvrir la discussion. Hitler traverse l’ouvrage, sans qu’il soit jamais examiné comme figure particulière. J. Chapoutot ne paraît pas lui prêter de rôle prépondérant dans l’élaboration de la doctrine nazie. Il synthétise, sans novation forte apparemment, la vulgate nazie qui l’entoure. Mais n’est-ce pas sous-estimer son rôle ? Les travaux de Ian Kershaw, entre autres, ont montré à quel point Hitler a incarné une nouvelle forme de pouvoir, un rapport inédit à l’image du chef, et un jeu sur le charisme. On ne saisit pas ici comment il devient le référent ultime d’une pensée nazie dont il serait un simple contributeur. Ni si quelque chose dans cette idéologie appelait la figure du chef ; car au fond la pensée nazie aurait pu n’être qu’un mode d’emploi (haineux) du monde, sans nécessité d’un leader charismatique. D’où vient la figure d’Hitler dans la pensée nazie ? Un court passage du livre rappelle que « fürher » est un titre militaire, suggérant que le rapport du chef à sa communauté est hiérarchique et martial. Mais, alors même que les nazis raillaient l’appel au sauveur du judaïsme et du christianisme, comment l’ont-ils importé dans leur pratique politique ?
L’ouvrage de Johann Chapoutot est un travail remarquable, colossal, une plongée dans la psyché nazie dont on ne sort pas indemne. Cette Allemagne, au cœur de l’Europe, a produit méthodiquement une incroyable armature intellectuelle capable de justifier la haine et le meurtre à l’échelle industrielle. Il n’y a pas loin des paroles aux actes, de la justification de la violence au passage à la violence ; et en ces temps troublés, faire une généalogie des conditions discursives et doctrinales du crime de masse, c’est faire œuvre utile.
07/06/2015


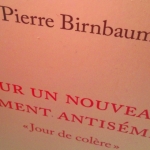
Pingback: ნიცშეს ჩრდილში,Homo sapiens-ის მკვლელობა, ზეადამიანი-”ღმერთის” წარმოება | ცოდნა გონების ფარია, თუ რომ
Pingback: გერმანელებს უნდათ აღმოსავლეთი – historyplusart
Pingback: უცნობი ისტორია ებრაელები ჰიტლერის ჯარში – historyplusart
Pingback: ნაციზმის პარადოქსი ებრაელები ჰიტლერის ჯარში – historyplusart