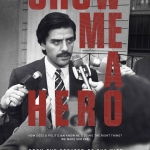Matthieu, mon camarade, te souviens-tu de nos premières rencontres, quand nous étions étudiants ? C’était hier, ou un peu avant, ne soyons pas dupes du temps. Un ami d’ami nous avait présentés. Je partageais avec toi une politisation joyeuse et un solide sens de la sociabilité. Nous fûmes de fiers équipiers, nous prêtant les livres qui comptaient pour nous, les dernières parutions en sciences sociales, traînant rue Mouffetard et place de la Sorbonne pour évoquer l’engagement possible, la dernière plateforme de l’UNEF-ID (c’était son petit nom à l’époque), ou la cohabitation entre Chirac et Jospin. Je crois qu’il était clair pour toi, Matthieu, que ces études te préparaient davantage au militantisme politique qu’à la distanciation du chercheur. Je te voyais bien occuper un poste électif, sans doute au Parti socialiste, et toi aussi. Après un DESS (M2), tu partis vers de nouvelles aventures, tandis que je m’engageais dans le tunnel de la thèse.
Le temps faisant, les nouvelles devinrent plus lâches, sur la carrière, sur les enfants, sur les femmes. Mais Facebook a suppléé à l’éloignement de la vraie vie, et les posts ont tenu lieu de lettres échangées. Tu as commencé à travailler dans l’administration. Rien de central, mais pas le bagne non plus. C’était près de chez toi, dans une grande ville de région. Tu as eu deux ou trois enfants (je n’ai pas vraiment compté), te séparant régulièrement, payant des pensions, puis retentant pour un temps le coup du grand amour. Les visages de femmes changeaient sur les photos en ligne (je n’ai plus vraiment compté…).
A l’approche de la quarantaine, l’impression que tu n’avais pas le rôle politique que tu espérais, ou que la politique hollandiste n’avait pas la grandeur attendue, a commencé à peser sur toi. Pour tout dire, tu n’avais pas eu de carrière politique. Tu étais juste militant, éternel compagnon de route d’aucun parti, simple commentateur instruit de la vie politique française. C’était une position confortable, celle de ne pas s’engager réellement, mais aussi très frustrante, de ne peser sur rien, de n’être devenu ni l’élu ni l’universitaire qu’on invite sur les plateaux, même si leur parole ne porte pas vraiment. Sur Facebook – car il ne restait plus que Facebook comme fenêtre sur nos vies respectives – ton lexique s’est fait plus véhément. Difficile à dater, peut-être sous la présidence de Sarkozy, mais les noms d’hommes politiques ont commencé à se voir adjoindre les mots « ordure », « pourriture », ou « ce connard de ». Il a semblé qu’à un moment tout le monde avait « trahi ». Que personne n’était jamais assez à gauche, que personne ne voulait appliquer la « bonne politique » que toi tu avais repérée, la « vraie » politique de gauche, loin du marché, des baisses d’impôts, des « cadeaux faits aux riches », du néo-libéralisme, de la libre entreprise, comme de l’économie numérique. Il a semblé qu’à un moment tu ne lisais plus que Lordon, Mouffe et les Pinçon-Charlot. Il a semblé qu’à un moment c’était la classe politique tout entière qui avait basculé du côté obscur, que c’était la professionnalisation même qui était une trahison. Cette professionnalisation dont tu n’étais pas, et que tu t’interdisais désormais, barrant par principe le destin qui t’attirait quand tu étais étudiant.
La triade Blair, Schröder, Jospin – celui qui disait oui à l’économie de marché, mais non à la société de marché – marqua le moment où tu classas la sociale-démocratie à droite. Il ne restait pour toi, dès lors, plus rien à gauche, et le « mal » paru recouvrir de son ombre tout l’univers politique. Dans Le Monde, les billets économiques d’Eric Le Boucher te rendaient fou de rage. Il ne devait être que le premier d’une liste de journalistes promis au bûcher, que tu allongeais chaque jour. Dans le désert politique laissé par la capitulation des forces de gauche, il n’y eût longtemps rien, sinon une maigre « alternative rouge et verte », qui était trop loin de ton ancienne famille partisane, puis l’altermondialisme au début des années 2000, mais trop sur des enjeux internationaux, et enfin, heureusement, le Front de Gauche, qui incarna pour toi le retour des tribuns et d’une gauche révolutionnaire sans les habits trotskistes poussiéreux du NPA ou de LO.
Tes posts sont tous devenus très virulents, versant dans un poujadisme langagier jamais interrogé, décourageant toute discussion, et embarrassant parfois tes amis. Rien n’était plus sauvable à tes yeux, sauf peut-être ce personnel politique d’extrême gauche, et encore, Mélenchon t’apparaissait comme un ancien socialiste opportuniste, dont la virginité ne serait jamais rachetable. On pouvait sauver Ruffin, et, ailleurs, Taubira. La sociologie politique t’avait convaincu que les changements de partis ne devaient rien aux idées mais tout aux carrières. On ne « trahissait » donc que pour son intérêt, jamais par conviction. D’ailleurs, tu ne voyais plus que des « traîtres » : Sarkozy avait trahi Chirac, Balladur aussi, Kouchner avait rallié un gouvernement de droite, Benhamias n’était plus écologiste au Modem, Valls était un affreux souverainiste laïcard qui avait infiltré la gauche. Quant à la génération des Julien Dray et des Henri Weber, son passage du trotskisme au socialisme n’avait fait que la pervertir et la transformer en une bande d’apparatchiks coupés du réel. Tous les élus de premier rang te semblaient avoir trempé dans les magouilles d’appareil ou dans celle des financements occultes. Tous te semblaient compromis, soutenant ici une guerre, là une politique publique indigente. Le monde politique, celui qui était l’objet de toutes tes passions et tous tes commentaires, était devenu une arène décadente qu’il fallait brûler.
Ton dégagisme fut mélenchoniste à l’élection de 2017, et la victoire du Macron la réalisation de ton pire cauchemar. Lui incarnait tout ce que tu avais patiemment haï, les élites méprisantes, les énarques perchés, les banquiers comploteurs, les fans béats du numérique, les mille couteaux dans le dos qu’avaient du planter ceux qui l’avaient rejoint en provenance de l’UMP et du PS. Son triomphe, même face à Le Pen, te fit désespérer du pays. D’ailleurs, tu avais appelé à l’abstention au second tour, considérant que la peur du fascisme était désormais un vieux chiffon rouge agité par les macronistes et leurs soutiens de la 25e heure. Ton éducation antiraciste poussée et ton passage par SOS Racisme, avec port ostentatoire de la petite main jaune dans la cour du lycée, me racontais-tu, t’avaient vacciné contre la tentation lepéniste. Mais de plus en plus il te semblait que tout n’était pas à jeter dans son discours, la haine de Bruxelles, la préférence nationale sous la forme d’un patriotisme économique, l’anti-américanisme, le volet social du FN dédiabolisé, pouvaient te parler. Tu achoppais toujours sur le père, sur ce que tu savais du vieux fond vichyste du parti, de son négationnisme, de son racisme anti-arabe, mais la défense économique du pays n’était pas pour te déplaire, tout comme une vision autoritaire de ce que devait être un leader. Tu avais toujours été très « Français », voyageant peu, croyant que tout chez nous était ce qu’il y avait de meilleur dans le monde (de la gastronomie à la Sécurité sociale). Une fois où j’avais ri en te disant que j’avais mangé dans un restaurant peuplé de franchouillards rougeauds, tu m’avais sèchement remis à ma place en me disant que c’était un délit de faciès. Je me voulais sociologue de bazar, mais j’étais renvoyé à ton empathie pour les « petits blancs », pour le « Français moyen », qu’il ne fallait pas toucher. Pour toi, notre pays était ouvert aux autres, aux étrangers, aux immigrés, mais au fond plutôt comme invités que comme ayant volontairement choisi la même communauté de destin que nous ; et du reste nous devions renoncer à leur imposer nos « valeurs » ou nos us et coutumes, et si le patriarcat ou le voile régnaient en maître dans certaines familles, ce n’était pas notre problème.
A quel instant nos échanges sur la « société » ont-ils cessé ? Peut-être quand en 2015 tu as commencé à dire que tu ne voulais pas « être Charlie », que cet unanimisme compassé pour une bande de dessinateurs islamophobes te paraissait hors de propos. Nous étions tous Charlie comme jadis ils avaient tous été Spartacus, mais pas toi. Aux remarques sur la violence de l’islamisme, sur sa haine de l’Occident, sur sa bigoterie totalitaire, sur son antisémitisme, tu répondais inlassablement que la seule violence était celle du capitalisme, et que les attentats étaient des faits divers, dont les chaînes d’info en continu faisaient beaucoup de cas pour détourner le bon peuple de sa révolte à venir. Tu écrivais sur Facebook que l’islamisme avait de toute façon été produit par l’Occident, à cause des guerres au Proche-Orient ou à cause de la laïcité en France. Nous avions ce que nous méritions en somme, frappés par notre propre golem. A moins que nos échanges se soient arrêtés quand tu as commencé à soutenir l’annexion de la Crimée par la Russie de Poutine, et te faire l’écho des propos de Russia Today et autres sites de nouvelles « alternatives ». Nous étions désinformés par la presse française valet du capital, tu avais les yeux dessillés par ces myriades d’articles venus de l’étranger et qui, enfin, disaient la vérité que nous ne voulions pas voir. Décalqué dans l’ordre international, le triomphe des comploteurs était visible dans la morgue des pays du Nord, auxquels tu ne manquais jamais d’adjoindre Israël, et dans leur critique de pays maintenant chers à ton cœur, le Vénézuela, Cuba, l’Iran ou la Turquie. Il fallait être désormais contre « l’Empire », contre sa politique, contre ses sous-produits culturels, contre sa langue globalisée, et contre ses entreprises qui échappent à l’impôt partout où elles passent.
L’idée a commencé à germer en toi que seule la violence pouvait renverser le système, et tu te réjouissais bruyamment de la mort de tes « ennemis », Christophe de Margerie ou François Chérèque, dans des posts obscènes qui ne recueillaient que quelques likes polis (tu avais changé, mais tu n’avais pas changé d’amis…). Quand en 2015 un cadre des ressources humaines d’Air France fut poursuivi par une foule d’employés en colère, tu n’y vis qu’une juste rétribution de l’aliénation capitaliste, dans une pensée du talion qu’on croyait disparue.
Il fallait faire sauter le système. Tout de suite. Il n’y avait plus rien à attendre des palabres parlementaires et du temps trop long des politiques publiques. Plus rien à attendre des élections qui ne faisaient accéder au trône que des « présidents des riches ». L’urgence était maintenant. La souffrance ne pouvait plus durer. Il fallait un homme à poigne, qui dirait son fait à l’Union européenne et aux Etats-Unis. Il fallait être résolument « populiste ». Quand le mouvement des Gilets jaunes commença a émerger, tu te reconnus immédiatement dans cette France de la périphérie, de la douleur au travail, des fins de mois difficiles, celle que la gauche et Terra Nova avaient abandonnée, mais aussi dans sa lecture conspirationniste du monde, dans son accueil de Dieudonné en héros des pauvres, et dans sa volonté de faire rendre gorge aux élites, aux gens de la télé, aux « gros », aux nantis, tous idéologues, tous fainéants, tous payés à diffuser la bonne parole des dominants. Cette France-là était pour toi le peuple debout, devenant acteur de sa propre histoire. Un populisme indiscutable puisque produit par le peuple lui-même.
A chaque « acte » des Gilets jaunes, tu as commencé à poster des vidéos montrant ta préparation quasi militaire pour aller aux manifs, comme avant on « allait aux bastons ». C’était un peu effrayant à voir, ton exaltation, ton envie d’en découdre, ta haine de tout ce qui pourrait aller contre le mouvement, le nuancer, le critiquer, le diviser en somme. Les « quenelles » collectives et synchronisées, le flocage d’un ananas au sens codé, la présence de Gilets jaunes au capital politique plus fourni que ce qu’ils voulaient bien en dire, parfois venus de l’extrême droite, la haine des journalistes et des élus, tout te paraissait acceptable. Irrésistible. Tu as senti que ce mouvement avait quelque chose d’insurrectionnel, que la violence, ta violence, y serait possible, qu’on pourrait casser le système, faire peur aux bourgeois, et enfin sortir de l’immobilisme politique. L’occasion de l’engagement était trop belle, dans ce phénomène différent de tous les autres, sans leaders et sans partis, brouillon mais sincère, disais-tu, entier, libérant une parole trop longtemps contenue, et accompagné par quelques universitaires que le système n’avait pas encore récupérés. C’est la marée jaune qui te donne désormais ta force, qui te donne envie de repolitiser la masse des laissés pour compte, d’enfin diffuser ton savoir accumulé, dans une expertise rare en ces lieux, de subvertir le bas pour renverser le haut. Mais je ne sais si tu as été troublé de voir que ton militantisme était entièrement négatif, et que ton engagement était en fait une haine viscérale de la politique.
Es-tu en si bonne compagnie, pourtant, à chaque « acte » ? Surtout, que feras-tu quand tout sera retombé ? Vivras-tu dans une clandestinité mentale, résistant à une oppression que le peuple aliéné ne parvient plus à voir, et pensant que la politique est morte et qu’il ne reste que la lutte permanente ? Voudras-tu prendre les armes pour relancer de nouvelles années de plomb ? Je ne sais, Matthieu, si la haine parviendra à te quitter un jour. Je l’espère pour nous. Comme j’espère que le monde te redeviendra supportable, dans son inachèvement et son incertitude. Là même où la politique joue son rôle. Peut-être qu’un jour alors nous pourrons refaire le monde dans un café du Quartier latin.
Photos d’Anne Avy & Isaure Leroy-Avy (merci !)
15/03/2019, modifié le 08/04/2019