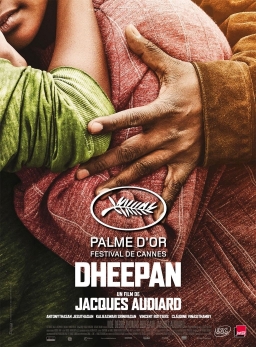Si l’on déplie le scénario concocté par Aaron Sorkin pour le Steve Jobs de Danny Boyle, on ne peut qu’être frappé par la lancinante question du temps, et de son immobilité. Le même scénariste, pour The Social Network (David Fincher, 2010) avait habilement, et plus classiquement, noué une intrigue courant sur deux temporalités différentes : celle du présent où Mark Zuckerberg faisait face à un contentieux avec ses premiers compagnons de route, et celle du passé, où le même, encore étudiant, inventait Facebook et montait son entreprise. Dans les deux lignes de temps, le protagoniste est tout entier tendu vers le futur. Soit qu’il s’y projette dans la phase de naissance de son projet, soit qu’il solde ce qui pourrait le lester, en gagnant sa procédure judiciaire ; ne restant prisonnier du passé que sentimentalement, cliquant sur le bouton « actualiser » de son navigateur pour voir si son ancien amour l’accepte enfin comme ami…
Le film de David Fincher a marqué, à la fois par son rythme syncopé (et le débit de Jesse Eisenberg n’y est pas pour rien), et pour la capacité, toujours renouvelée, du cinéma américain à s’approprier des phénomènes contemporains, et des icônes populaires, pour en faire la matière d’un film et les revisiter sans attendre un quelconque délai de rigueur. Le film a aussi marqué l’autre biopic de Steve Jobs, celui avec Ashton Kutcher sorti en 2013 et réalisé par Joshua Michael Stern. On y retrouve les réunions à fleurets mouchetés du board d’Apple, comme celui de Facebook, et la dureté du patron ambitieux qui se débarrasse sans égard de ses camarades des débuts, les spoliant de toute reconnaissance ou gratification. Si le Jobs de J. M. Stern n’est pas antipathique, et a des points communs avec celui de Boyle (musique de Bob Dylan, lyrisme autour du spot de pub « 1984 », fin de la narration avec le lancement de l’iMac coloré, etc.), son écriture demeure celle d’un biopic classique et linéaire temporellement, avec un héros qui ne peut que s’accomplir à mesure que les années passent.
Prisonnier du temps
Toute l’habileté du scénario de Sorkin, en revanche, est de simuler un récit linéaire, via la scansion de trois keynotes centrales (deux pour Apple et une pour NeXT) à trois moments différents du temps, alors qu’en réalité le personnage de Jobs et le récit font du surplace. A cet égard, la présence de Steve Wozniak lors de la keynote de 1998 est une apparition clairement fantomatique. Son insistance, bien après la bataille, à demander encore que l’équipe de l’Apple II soit publiquement remerciée n’a d’autre sens que de montrer un Steve Jobs clivé entre sa volonté d’inventer le futur et son emprisonnement dans le passé. Le fantôme de Wozniak donne la clef du récit, et de sa tension entre fidélité impossible à la genèse biographique et professionnelle, et capacité visionnaire à écrire le progrès technique (l’invention de l’iPod est suggérée en fin de parcours). Le dispositif théâtral en huis-clos répété ne fait qu’accentuer le sentiment de voir un Jobs prisonnier (de ses obsessions, de son métier, de ses conférences, de lui-même) que les fantômes de son passé viennent visiter tour à tour : son ex-femme, sa fille, John Sculley, Andy Hertzfeld, Steve Wozniak, vieillissants et évoluants, tandis que lui semble figé, se débattant dans les mêmes affres (et sa conscience, évidemment figurée sous les traits de la chargée du développement, Joanna Hoffman, jouée par Kate Winslet). Sans parler du traumatisme de son adoption, qui fait retour lors de la dernière séquence, et achève de river Jobs à un passé sur lequel il n’a aucune prise.
Le temps est encore au cœur du recours au flashbacks, par exemple dans les montages parallèles des entretiens avec John Sculley, pour montrer la trahison à l’œuvre entre les deux époques ; alors que Jobs est persuadé de sa fidélité à lui-même, quand tout s’effondre autour de lui (son licenciement d’Apple, le fiasco commercial de NeXT). Ce ne sont pas seulement les autres, les intrigants et les médiocres, qui bloquent son ambition ; car au fond il arrive à ses fins. C’est le temps. Et l’on sait à quel point le véritable Steve Jobs était préoccupé par la course du temps, et par la mort, désireux de rentabiliser chaque journée, et de densifier chaque minute. Dans son célèbre discours à Stanford en 2005, aux accents d’entrepreneur américain new age, il rappelait aux étudiants : « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d’autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. » Plus de dix ans avant, il avait déjà déclaré : « Etre l’homme le plus riche du cimetière n’a pas d’importance pour moi… Mais me coucher en me disant qu’on a fait quelque chose de merveilleux… c’est ce qui compte. » Dans le film de M. J. Stern, une courte séquence montre Jobs en Inde écoutant les mots d’un gourou qui dit que ce qui compte est « ce que vous faites du temps qui vous a été imparti. Le moment de votre mort est fixé ». Le vrai combat de Jobs n’est donc pas contre le « système », contre Microsoft, ou contre les actionnaires, mais bien contre le temps. Et sa fragilité touchante vient de là, alors que l’homme est odieux.
La machine à regrets
A cet égard, c’est bien la création qui peut densifier le temps, qui donne un résultat tangible, un produit manufacturé, un ordinateur ; et Jobs s’est toujours présenté comme un fabricant de hardware. Il est remarquable, au passage, qu’aucun des deux films ne fassent mention du rachat de Pixar à Lucasfilm par Jobs en 1986 ! Comme si ça ne faisait pas partie du même mouvement de sur-occupation du temps, et de capacité de projection extraordinaire sur ce qui allait devenir le futur de l’animation. Mais le film de Boyle ne s’attarde pas sur le processus de création, ni sur les keynotes elles-mêmes (sauf par le biais d’une répétition pour celle, triomphale, de 1998). Il ne filme pas chaque petite révolution technologique ou de design (le designer Jonathan Ive n’apparait pas dans ce film-là). Boyle déjoue surtout l’attente du « génie » en action, car très vite le seul talent prêté à Jobs est celui de transformer les potentialités des autres et d’anticiper des pratiques. Mais il filme bien, et sans son hystérie habituelle, la conjugaison rare entre la vision d’un homme, la traduction technique qu’il est capable d’en faire, et la direction de son entreprise (a contrario une biographie de, disons, Stéphane Richard, PDG d’Orange, serait sans grand intérêt tant il semble extérieur à l’entreprise qu’il dirige et ne porte pas d’inventivité technologique particulière ; et, dans un autre genre de capitaine d’industrie, je crains le jour où un scénariste français écrira le biopic de Xavier Niel…).
Ce sont évidemment les machines qui font obstacles entre Jobs et le monde, alors même qu’il les fabrique pour libérer la création et le travail. Lors de la première visite de Chrisann, le nouvel ordinateur s’interpose entre elle et son ex compagnon allongé sur le canapé. Si la scène où Lisa dessine avec MacPaint est troublante, parce qu’elle montre les premières hésitations de gestes qui nous sont désormais familiers (comme l’est l’interface graphique), elle l’est essentiellement parce qu’elle dit que Jobs a virtualisé toutes ses relations humaines. C’est l’ordinateur, régulièrement upgradé, qui parle au monde, pas Jobs. Et le démontage par la statistique de sa paternité certaine annonce le triomphe des algorithmes dans les années 2000.
Ce que devait craindre Jobs c’est l’embaumement vivant, la muséification de l’ordinateur, qui devrait être un produit toujours contemporain. Mais le film contrebalance cette quête du présent absolu par des invocations spectrales. Comme si la seule machine qu’avait fabriquée Steve Jobs était une machine à regrets.
21/02/2016