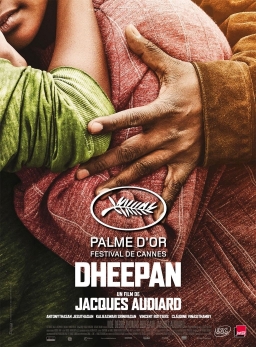A propos d’American Sniper, réalisé par Clint Eastwood (2014)
Les Etats-Unis n’ont pas eu d’armée jusque pratiquement la moitié du XIXe siècle. Si la perception européenne voit aujourd’hui dans ce pays un « gendarme du monde, plus ou moins inspiré, et soumis à des injonctions contradictoires (sur le mode « il ne fallait pas aller en Irak, mais il fallait aller en Syrie »…), la perception que les Américains ont de leur armée est sans doute différente. Il s’agit pour eux, d’une part, d’une armée qui ne défend pas la patrie sur le sol continental (et n’assure pas d’opérations internes de maintien de l’ordre), et reste exclusivement engagée sur des terrains extérieurs. Et d’autre part, dans les films contemporains, le thème du retour des soldats est au moins aussi important que le thème des opérations militaires elles-mêmes ; la figure matricielle d’un John Rambo en témoigne pleinement. Il s’agit souvent d’explorer ce que la guerre fait au corps et à l’esprit des combattants, et American Sniper ne fait pas exception à la « règle » ; règle posée par Né un 4 juillet, d’Oliver Stone (1989), ou Voyage au bout de l’enfer, de Michael Cimino (1978), par exemple. On retrouve d’ailleurs dans le film de Cimino et dans celui d’Eastwood une scène de mariage qui précède l’incorporation ; le « prélèvement » que fait l’armée des corps venant interrompre le flux social et vital.
Surtout, l’extériorité des combats, leur étrangeté pour ceux qui sont restés au pays, fait des vétérans des individus qui ont vécu une expérience indicible et non partagée par leurs concitoyens. Leur retour apparaît alors toujours comme une anomalie, pour eux comme pour ce qui est devenu une « société d’accueil ». Ils portent en eux un conflit qui n’aura été vu que par médias interposés, et au fond un conflit nécessairement lointain ; contrairement à ce qu’avaient pu vivre les sociétés européennes lors des deux conflits mondiaux. Dans une société pacifiée, la guerre est un bruit de fond, dont la réalité quotidienne échappe aux simples spectateurs. « Il y a une guerre là-bas et personne n’en parle », dit à un moment le personnage de Chris Kyle dans le film d’Eastwood, pour montrer non pas seulement le fossé qui le sépare de ses contemporains, mais surtout sa difficulté à faire vivre son engagement physique et moral bien réel à ceux pour qui la guerre est déréalisée. Eastwood joue bien du décalage d’échelle entre l’idéalisme du héros qui souhaite partir pour « servir son pays », et la basse réalité de cette activité. Habilement d’ailleurs, le réalisateur suggère l’idée que le maniement des armes et la volonté d’être le protecteur des plus faibles vient de l’éducation paternelle, sans dimension politique, et c’est aussi ce que donnera Chris à son fils dans une séquence homologue. Tout aussi habilement, Eastwood ne néglige pas le rôle des images (d’attentats et de violence) comme moteur de l’action et de l’engagement.
L’impensé de la matérialité de la guerre est un classique. Mais ce qui l’est moins, en tout cas depuis Démineurs (Kahtryn Biglow, 2008), c’est que ce qu’on dénomme « la guerre » est montrée comme une série de gestes, de pratiques, de routines, de mots, et finalement de « sales boulots » qu’il faut bien accomplir pour achever les missions. Dans ce dirty work guerrier, le personnage du tireur d’élite fait le plus ambigu des sales boulots, au sens où sa protection des détachements implique de tuer des hommes, des femmes et des enfants à distance, et sans engagement direct. Chris Kyle finira d’ailleurs par se joindre à ses camarades immédiatement aux prises avec le combat rapproché, pour se rendre plus utile à ses yeux. Au passage, sa mission évolue tout au long du film, commençant en protection des troupes au sol pour finir en un duel avec Mustafa, son double mimétique du côté des insurgés. C’est d’ailleurs une fois cette mission accomplie qu’il juge bon de rentrer, laissant la tempête de sable obscurcir l’image et recouvrir toute son action d’un écrasant linceul.
Au plus près des corps, la guerre d’Eastwood est crasseuse, pisseuse, sanglante. Le patriotisme originel se dilue dans de petites missions à courte vue, où le sniper est le seul à pouvoir voir de loin, en longue vue donc, échappant un peu à la condition de Fabrice à Waterloo. Mais le doute du réalisateur, qui se dit libertarien depuis un moment, et opposé aux interventions extérieures, se distille partout. Dans les mots de Taya, l’épouse de Kyle, mais ils restent faibles face à un homme emmuré en lui-même. Dans les mots aussi des compagnons d’armes, ou du frère de Chris, qui, blessés ou épuisés, ne veulent plus se battre et interrogent la profondeur de leur engagement. On n’aime plus l’odeur du napalm au petit matin: les soldats filmés par Eastwood finissent par tomber, et Chris revient aux Etats-Unis en voyageant au milieu des cercueils de ses pairs. Si la réception critique du film a pu s’interroger sur la dimension « patriotique » ou conservatrice du film, qui héroïse un tueur froid, il est clair quand même qu’Eastwood ne refait pas Les Bérets verts de John Wayne (1968), apologie décalée des soldats américains, dans une guerre du Viêtnam souvent présentée comme la fin de l’innocence américaine. Si effectivement l’innocence guerrière des Etats-Unis a pris fin en 1975, la question se pose désormais de savoir quoi filmer quand on filme la guerre.
La caméra d’Eastwood est une caméra embedded, mais elle filme aussi les hésitations du héros, sa démolition intérieure, sa reconstruction inespérée (et assez vite traitée). Elle filme un homme que tout le monde surnomme la « Légende », à cause du nombre de gens qu’il a tués. Cette idée d’une « légende » est la clef du film. « Qui compte ? « , demande ironiquement Chris à l’un de ses camarades qui lui indiquait le nombre de ses cibles. A aucun moment le personnage ne se réclame de ce surnom, ni ne se glorifie de ses actes ; il est d’ailleurs régulièrement taquiné par ses camarades sur ce point. Mais ce qu’Eastwood filme depuis longtemps maintenant, c’est la mise en récit des grands moments de l’histoire américaine, de la conquête de l’Ouest à la Seconde Guerre mondiale. Ici, un récit de la guerre en train de se faire, qui s’écrit simultanément, qui invente sa propre légende (dont bien sûr le film lui-même participe). Écrire la légende implique d’être toujours au bord du fantastique, de convoquer des fantômes (L’homme des hautes plaines, Pale Rider), de faire parler les morts (Lettres d’Iwo Jima), de détruire les images de guerre devenues iconiques (Mémoires de nos pères), de restituer l’âme tourmentée de ceux qui côtoient la destruction de l’homme par l’homme, et bien sûr, s’il le faut, d’imprimer la légende plutôt que la réalité, si la légende est plus belle ; c’était posé explicitement par le personnage de l’écrivain, W. W. Beauchamp, dans Impitoyable. Dans American Sniper, Eastwood entend s’approcher au plus près du « héros de guerre » contemporain, mais pour immédiatement et systématiquement l’instituer dans son humanité, dans sa trivialité, dans ses doutes, dans l’éreintement qui le saisit au fur et à mesure que le temps de la guerre se dépose dans son corps ; éreintement visible dans sa volonté farouche de ne pas tuer le jeune garçon qui se saisit d’un lance-roquettes. Moment où, pour la première fois, c’est bien le fait de ne pas appuyer sur la gâchette qui provoque la toux, la fatigue et le surgissement d’un corps qui ne peut en supporter davantage ; au risque sinon de mourir comme les camarades. Éreintement qui est aussi celui du spectateur dans la succession des « tours« , où le quatrième semble surnuméraire, avant que face au médecin on ne saisisse le temps total de plus de mille jours passés sur le terrain. A chaque retour, Chris est un mort-vivant dans sa famille et dans son environnement, sursautant au moindre bruit, transformant le jardin où jouent les enfants en un champ de bataille qui révèle son traumatisme. Il n’est dès lors pas ironique qu’il soit tué aux Etats-Unis mêmes par un frère d’armes plus abimé que lui. Car la guerre revient toujours avec ceux qui l’ont faite ; mais il faut quand même parvenir à refaire communauté, en l’absence d’un Etat fort à la française qui s’en charge en permanence. C’est le sens des derniers plans, très incompris, de Voyage au bout de l’enfer, comme ici des derniers plans du public accompagnant le convoi de Chris ; images authentiques du patriotisme américain, qui nous échappe vu de France, où l’on n’a pas toujours été Charlie, et où le nom des soldats tombés pour la patrie nous demeure inconnu.
21/02/2015