La fusillade en partie évitée dans le Thalys il y a deux jours, et l’intervention de deux ou trois personnes pour désarmer le tireur pose la question plus générale des effets de la tension entre civilisation et brutalisation, et entre civilisation et refoulement. « Civilisation » au sens de Norbert Elias, celle des mœurs et des manières, celle de la maîtrise soi et du contrôle des pulsions des violence et d’agressivité, à partir du moment où historiquement c’est l’Etat central qui prend à sa charge le monopole de la violence physique légitime, et donc, ce qu’on oublie souvent, qui décharge les citoyens de toute possibilité de manier les armes, comme de se faire justice eux-mêmes. Il n’y a pas en France de permis de port d’armes généralisé (sauf dans des cas particuliers, ou pour les activités cynégétiques), et il n’y a pas non plus de milices de citoyens armés, ou de vigilante. Nous sommes habitués à être désarmés. Et nous sommes habitués à ce que seules la police et l’armée soient armées ; incarnant la légitimité de la violence physique « légitime ». Même si le degré de violence répressive auquel peut prétendre la police fait en permanence l’objet de discussions, qui sont des discussions éminemment politiques. Divers travaux de sciences humaines, comme ceux de Patrick Bruneteaux ou Jean-Marc Berlière signalent depuis le début du XXe siècle un mouvement de « répression de la répression » policière (Bruneteaux), c’est-à-dire un moindre recours à une violence mortifère dans le maintien de l’ordre (et notamment dans la gestion des manifestations), qui est la condition d’une police républicaine. Ce mouvement, qui est une des manifestations de la civilisation des mœurs, s’inscrit généralement dans le passage d’un maintien de l’ordre assuré par l’armée, qui ne sait que « détruire » ses ennemis, à un maintien de l’ordre assurée par la police, qui cherche à neutraliser des adversaires. Cette républicanisation du maintien de l’ordre, encore discutée par les spécialistes, rend dès lors insupportable tout débordement de la violence policière (la « bavure »), et tout décès d’un civil imputable à la police ou à la gendarmerie (les deux cas récents lors de manifestations étant Malik Oussekine en 1986 et Rémi Fraisse en 2014).
La gestion d’une manifestation est, en France, une affaire ritualisée depuis longtemps, tout étant négocié en amont entre la préfecture, le service d’ordre et la police. L’intériorisation des normes manifestantes par tous les acteurs de la manifestation rend l’irruption de la violence improbable, et chacun sait qu’il peut aller manifester sans mettre sa vie en danger ; sauf précisément quand le rituel se casse, et dévoile que la violence était prête à surgir (arrivée de « casseurs » extérieurs au cortège, policiers inexpérimentés qui paniquent, etc.). Hors contexte manifestant, en revanche, toute situation de tension entre police armée et individus désarmés peut dégénérer et basculer rapidement dans la violence (émeutes en banlieue, affrontements comme celui de la gare du Nord à Paris en 2007).
La situation française est celle d’une intériorisation par les individus de la nécessité de leur désarmement. A l’inverse aux Etats-Unis, comme dans d’autres pays (Canada, Israël, Russie, Suisse) les politiques sont plus libérales concernant le port d’armes. C’est un droit constitutionnalisé aux Etats-Unis (IIe amendement). Là, la légalisation du port d’armes n’est pas liée à une fascination des Américains pour la violence (vision culturaliste, s’il en est), mais à la construction de l’Etat. Un Etat faiblement centralisé comme l’Etat américain (de par la forme fédérale du régime, mais pas seulement) est un Etat qui ne saurait prétendre à un quelconque monopole de la violence, particulièrement concernant les territoires éloignés du centre, où les individus ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour se défendre (ce sont d’ailleurs aussi des territoires où la peine de mort est toujours en vigueur ; Etats du Sud, Texas, et Californie). Comme l’analyse Stephen Mennell, disciple de Norbert Elias, dans son riche livre sur le processus de civilisation aux Etats-Unis, le fort taux de criminalité aux Etats-Unis n’est pas relié à une fascination américaine pour la violence, mais simplement au fait que la moindre rixe peut devenir mortelle si les protagonistes ont une arme à feu, là où elle serait moins grave s’ils étaient désarmés.
Alors, à Etat fort population désarmée, et à Etat faible population armée ? Ce n’est pas si simple historiquement, car en France la possibilité d’armer les citoyens a été très discutée sous la Révolution, notamment pour aligner tout le monde sur la noblesse qui avait le droit de porter une arme. Dans la perspective du libéralisme politique, la possibilité de se défendre soi-même, sans attendre un quelconque renfort étatique, relevait de l’évidence. De même que l’idée d’un soldat-citoyen n’était pas contraire à l’idée d’un citoyen armé. Au tournant XIXe-XXe siècles, nombre de soldats démobilisés en 1870 sont rentrés chez eux avec des armes, et le maniement des armes est apparu comme une nécessité pour tout homme digne de ce nom. Les salles d’armes se sont multipliées à Paris à cette époque, et le recours au duel était important au XIXe siècle, avant de s’éteindre après 1918. Epées et cannes-épées étaient des attributs de virilité et de distinction, dont l’épée des Académiciens est aujourd’hui la lointaine héritière. Il y eut donc en France ces quelques éléments relevant de la fascination pour le combat et de la brutalisation ; mais la civilisation des mœurs a balayé ces pratiques, et a désarmé les citoyens français.
Les sociétés occidentales sont désormais des sociétés pacifiées. Avec pour conséquence, comme le notait Hugues Lagrange dans un article de Déviance et Société, que les individus ne savent plus se battre. La violence est refoulée, que ce soit dans les images, comme nous avions eu l’occasion de l’analyser récemment, ou que ce soit dans la pratique. On atteint ce moment qu’évoquait Norbert Elias où la civilisation confine au refoulement, au refus de voir ou de savoir, au risque du trauma. Ainsi, pour boucler notre propos, même si Bernard Cazeneuve a insisté (avec un brin de chauvinisme ?) sur le fait que le premier à avoir tenté de désarmer le tireur du Thalys était bien un Français, il semblerait que ce soit des Marines américains, entraînés au maniement des armes, qui ont entendu le bruit de la culasse du fusil, puis qui aient ensuite désarmé et plaqué l’homme au sol. D’autres auraient-ils pu le faire ? Des ressortissants d’un pays où une conscription régulière est en vigueur ? Je n’en sais rien ; les situations produisent aussi des actions. Mais il est intéressant de noter que certains passagers ont pensé que l’arme était un jouet, car littéralement, comme leurs concitoyens, ils ne sont plus familiers des armes. La violence est pour eux désarmante parce qu’ils sont désarmés depuis bien longtemps.
Sautant sur l’occasion, le représentant d’un syndicat de police a demandé à ce que les policiers hors service puissent être armés. Mais ça n’implique pas qu’ils soient à bord des trains, comme il y a apparemment un policier en civil à bord des avions (enfin, peut-être). Pour moi qui prend le train des dizaines de fois par an, j’ai pu constater à quel point ce mode de transport était une cible molle…
23/08/2015

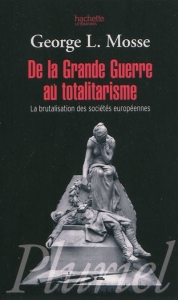
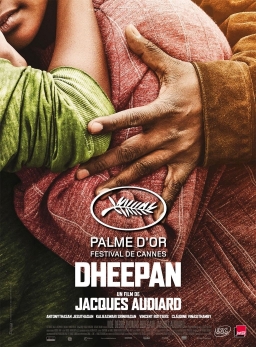


En fait, je ne suis pas sûr qu’il ne fasse pas faire aussi une distinction inspirée de la longue durée : entre savoir/vouloir/pouvoir se battre en amateur et savoir/vouloir/pouvoir se battre en professionnel. Dans la société violente du Moyen-Age, qu’un Elias présente comme pré-étatique, le « métier des armes » était distinct, ne serait-ce que par son efficacité meurtrière face à la plupart des révoltes paysannes qui étaient l’œuvre d’amateurs en matière de violence. Or cette distinction reste valable : il y a sans doute toujours des professionnels, mais, de moins en moins d’amateurs. En même temps, sur l’histoire longue, les histoires de brigands, pillards, soudards qui attaquent des paysans sans grandes défenses sont légion. Je distinguerais donc entre l’interdit psychologique de la violence dans nos sociétés, et la capacité technique à l’exercer ou à s’en protéger. On peut avoir envie d’être violent, sans savoir comment être efficace dans sa violence. Enfin, avec ce genre de réflexions, tu vas être l’inventeur de la protection civile intégrale, que l’État organisera et qui préparera chaque citoyen à se défendre au cas où, avec ou sans armes d’ailleurs. Une sorte de radicalisation de « Vigilant ensemble » à la Vigipirate. Cela vaudra mieux d’ailleurs que la « contrôlite » totalement inutile que certains pourraient inventer.
Je suis d’accord avec toi sur la distinction historique entre amateurs et professionnels de la violence. Il y a eu un métier des armes, quand même d’abord réservé à une classe, mais qui se curialise, et, à un moment, ne sait plus faire. Et puis ça passe d’une classe à un groupe professionnel, division sociale travail oblige. Dans l’intervalle, l’idée du soldat-citoyen s’étiole. Ce qui m’intéresse, c’est cette disparition. Du coup, effectivement, il y a de moins en moins d’amateurs. Mais je me demande si même le citoyen « pacifié » qui voudrait être violent « saurait » l’être, à la fois dans le dépassement de l’interdit psychologique, et dans la dimension technique (ça s’achète comment une kalachnikov…?).
Le vigilantisme est inquiétant, et j’ai la naïveté de toujours lui préférer un Etat monopolistique fort sur ces questions, plutôt qu’un far-west anomique ou un état hobbesien. Mais le désarmement est tout aussi inquiétant, et je suis surpris de voir que le monopole de la violence s’arrête dans les gares et ne monte pas à bord des trains. Comme en témoigne les dernières mesure(tte)s annoncées par Guillaume Pépy, où tout se passe en gare, et où l’appel au contrôle visuel des individus me paraît un vœu pieu.
Après, il reste la solution intermédiaire si on ne veut ni armer ni désarmer tout le monde, ce que font par exemple certaines femmes indiennes qui apprennent des techniques de self-defense, face à la multiplication des agressions dont elles sont l’objet. Ce serait peut-être une piste…
Il me semble que ce post fait largement écho à ton billet dans la Vie des Idées de juillet dernier et qu’il traduit une certaine inquiétude, pour ne pas dire une inquiétude certaine…
En tant que femme, et particulièrement « désarmée » tant que le plan physique que psychologique (je précise qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre les deux !), je me pose tout de même une question… « soldat citoyen »… pourquoi pas, mais de quoi ?
Et faudrait-il « redécouvrir » la possibilité d’une violence assumée et revendiquée qu’en réponse à une autre expression de violence physique ou peut-on élargir le champ des possibles ? Mais alors, jusqu’où ?
Le champ des possibles n’est pas infini. Je ne suis effectivement pas certain qu’une nation de citoyens-soldats-en-interne (car c’est bien de cela qu’il s’agit) soit souhaitable. Mais un ex-Etat monopolistique affaibli ne l’est pas non plus. Je donne juste là-dessus quelques pistes de réflexion, sans avoir hélas de solution clef-en-main.
En revanche, il est clair que depuis un moment j’explore la question de la violence interne, de ses formes et de ses effets, et que ça renvoie à ce que j’appellerai une « intranquillité ». Si on part des événements récents (mais on pourrait remonter plus loin, à Mohamed Merah, par exemple), on voit qu’il y a eu beaucoup d’écrits sur le 11-Janvier, sur ce que pouvait signifier politiquement un rassemblement aussi inédit ; avec y compris, dans les mêmes écrits, les manières d’orienter sa politisation (voire sa dépolitisation…). Mais il me semble qu’on a encore peu de choses sur la séquence 7-9 janvier, c’est-à-dire sur le moment du passage à la violence.
Et si aujourd’hui, on a une concomitance entre l’absence de médiatisation de la violence politique, le « désarmement » des citoyens (oui, physique et psychologique, et pratique), et l’étrange insouciance que j’observe quand je marche dans les rues de Paris, alors, oui, on peut être dans « l’intranquillité », tant le refoulement des événements est visible…